
Nioussérê Kalala OMOTUNDE
Co-fondateur de l'institut d'histoire Anyjart
Diopien, Écrivain, Conférencier, Chercheur en histoire, Égyptologue, Co-fondateur de l’Association Anyjart, Spécialiste des Humanités Classiques Africaines, Spécialiste des Sciences et Mathématiques Africaines.
À l’international, il a contribué à la création de nouvelles associations autour des Humanités Classiques Africaines : Martinique, Guyane, Haïti, Canada et de nombreux autres projets.
Ce fervent défenseur des Humanités Classiques Africaines a contribué à « faire mieux connaître notre culture ancestrale et à apprécier ses liens avec notre modernité ».
C’est aussi un brillant enseignant qui a su traduire dans un langage accessible des textes hautement
scientifiques, souvent issus d’écrits antiques. « Son approche méthodologique est respectueuse des travaux initiés par les professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, dans une démarche objective et humaniste ».
Il a utilisé « une documentation universelle telle des fouilles archéologiques, des datations, des testaments d’auteurs anciens, etc. ».



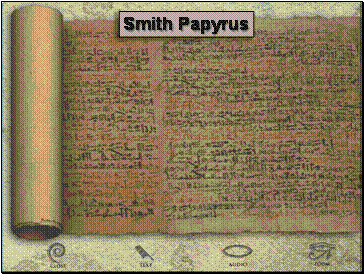
Les papyrus de médecine de l’Afrique ancienne
L'étude des papyrus médicaux montre que, pour les Égyptiens, la santé ou la maladie dépendaient essentiellement de souffles d'origine extérieure. Les traitements visaient principalement à débarrasser le corps de ces souffles et des éléments pathogènes qui les animaient (1).
Article écrit par Thierry BARDINET (chirurgien-dentiste et docteur en sciences historiques et philologiques de l'École pratique des Hautes Etudes).
Avant qu'en 1822 Jean-François Champollion ne trouve la clé des hiéroglyphes et ne permette ainsi l'accès aux textes de l'Égypte ancienne, notre connaissance de la médecine égyptienne se résumait à quelques témoignages de l'Antiquité classique, tels ceux d'Hérodote: «La médecine chez eux est divisée en spécialités: chaque médecin soigne une maladie et une seule. Aussi le pays est-il plein de médecins, spécialistes de la tête, du ventre, ou encore des maladies d'origine incertaine. [...] Voici leur genre de vie: ils se purgent pendant trois jours consécutifs chaque mois et cherchent à se maintenir en bonne santé par des vomitifs et des lavements, dans l'idée que toutes nos maladies proviennent de la nourriture absorbée.»
Grâce à de nombreux papyrus médicaux égyptiens que le hasard des fouilles a fait connaître depuis le XIXème siècle, nous savons aujourd'hui que l'organisation de la médecine égyptienne était différente de celle que rapportait Hérodote, bien que les «spécialités» dont il évoque l'existence correspondent à des titres de médecin retrouvés dans les inscriptions.
Après avoir examiné les circonstances des découvertes des papyrus, nous verrons que les nombreuses études qu'ils ont suscitées sont loin de répondre à toutes les questions. Ceux qui ont voulu identifier les maladies évoquées par les papyrus se sont souvent fourvoyés parce qu'ils attribuaient aux médecins égyptiens une connaissance moderne des maladies. En outre, ces études n'avaient pas fourni une explication générale des conceptions médicales égyptiennes.
Grâce à une nouvelle traduction de tous les papyrus médicaux publiés, on montre aujourd'hui que, pour l'Égyptien, la maladie est quelque chose qui vient du dehors, un souffle morbide. Ce souffle, qui est parfois apporté par une substance ou un être maléfique, pénètre et circule dans les conduits qui parcourent le corps.
En conséquence, les thérapies visaient principalement à chasser ce souffle pathogène. Cette conception de la médecine égyptienne trouve ses origines dans la mythologie et dans la conception de l'organisation du monde de l'époque: des souffles omniprésents déterminaient la santé et aussi la croissance ou la mort.
Des sources suffisantes
Les sources issues de fouilles sont nombreuses. Le premier papyrus médical trouvé, aujourd'hui conservé au musée de Berlin, fut mis au jour dans la nécropole de Saqqarah et publié en 1863, donc bien après la mort de Champollion ( 1832). Ce papyrus de Berlin date du règne de Ramsès II (vers -1200). Des documents souvent plus anciens apparurent par la suite, au cours de fouilles clandestines ou officielles: parmi ceux-ci, les deux plus importants sont les papyrus Ebers et Smith.
Ces deux papyrus, qui datent de -1550, auraient fait partie d'une seule trouvaille (clandestine, vers 1860, dans la nécropole de Ramsès II, à Thèbes) qui comprenait aussi le papyrus mathématique Rhind, lequel témoigne de la plus ancienne utilisation connue du calcul décimal. Les deux papyrus médicaux furent acquis par l'Américain Edwin Smith, grand amateur d'antiquités qui vivait alors à Louqsor. Smith garda pour lui le papyrus qui porte maintenant son nom, un traité chirurgical que James Henry Breasted publia bien plus tard, en 1930. Smith vendit à l'égyptologue allemand Georg Ebers le plus long des deux papyrus médicaux.
Le papyrus Ebers est un manuel qui donne la liste des signes pathologiques rencontrés par un médecin dans son exercice quotidien. C'est le document majeur pour l'étude de la pensée médicale de l'époque. Le traité chirurgical du papyrus Smith est d'un abord plus direct, car il traite de lésions et de traumatismes qu'un médecin d'aujourd'hui peut reconnaître, mais il ne donne pas une vision claire des connaissances médicales égyptiennes.
Une peinture découverte sur les parois de la tombe d'lpouy (un chef des sculpteurs de la XXè dynastie, -1100), à Thèbes, montre des ouvriers qui construisent une estrade funéraire. Elle illustre quelques accidents de travail. Un ouvrier ayant reçu un éclat de pierre dans l'oil se fait soigner par un oculiste. Ailleurs, un ouvrier reçoit un maillet sur le pied. Plus loin, un médecin remet une épaule démise.
Un autre document qui provient de fouilles officielles, le papyrus trouvé à Kahun, écrit pendant le Moyen Empire égyptien (vers -1850), est le plus ancien traité de gynécologie connu.
Le papyrus Ebers et le papyrus de Berlin détaillent aussi des remèdes pour les maladies des femmes, des pronostics pour le déroulement de la grossesse, mais aucun ne traite ces sujets aussi systématiquement que le papyrus de Kahun.
2. LE PAPYRUS SMITH, découvert en 1860 à Thèbes, est un manuel chirurgical d'une vingtaine de pages qui permet au médecin d'agir face à des blessures caractéristiques. Ce passage du papyrus se rapporte au traitement d'une luxation de la mâchoire inférieure: «Si tu procèdes à l'examen d'un homme atteint d'un déboîtement de la mandibule, et que tu constates que sa bouche est ouverte, sa bouche étant Incapable de se fermer, tu devras placer tes pouces aux extrémités des deux griffes de la mandibule, à l'intérieur de sa bouche, et tes autres doigts sous son menton. Tu feras aller les griffes vers le bas de sorte qu'elles soient remises en place. Tu diras à ce sujet: "Un homme atteint d'un déboîtement de la mandibule, un mal que je peux traiter." Tu devras le panser avec de l'irmou, du miel, chaque jour, Jusqu'à ce qu'il aille bien.
3. LE PAPYRUS EBERS, le plus long papyrus médical égyptien (108 pages), date de 1550 ans avant notre ère. Il a permis de mieux comprendre les connaissances médicales de l'époque pharaonique. Ce papyrus, ainsi que les autres papyrus médicaux, étalent des manuels pratiques plutôt que des ouvrages théoriques. Il indique des traitements contre de nombreux maux. Cette page traite des affections des dents et des malades pestilentielles: «Remède pour maintenir en état une dent: farine d'épeautre-mimi :1; ocre :1; miel; 1. Ce sera préparé en une masse homogène. Bourrer la dent avec cela. Autre remède: poudre de pierre à meule :1; ocre :1; miel :1. En bourrer la dent ...»
Enfin, en 1989 fut publié le papyrus de Brooklyn, dont on ignore la provenance. Édité par Serge Sauneron dans les collections de l'institut français d'archéologie orientale, il date de la XXXème dynastie ou bien du début de l'époque ptolémaïque (-300). Sa publication révèle les grandes facultés d'observation des anciens Égyptiens.
Le papyrus comprend deux parties. La première classe près de 40 serpents selon des critères d'identification précis, qui montrent une connaissance approfondie des différents reptiles, de leurs mours, du danger de leur venin et des spécificités de leurs blessures. La seconde partie est un recueil d'antidotes, proposant tout d'abord plusieurs remèdes contre les morsures venimeuses en général, puis d'autres contre les morsures de serpents particuliers. Ce papyrus, unique témoignage d'une véritable science égyptienne des serpents, résume probablement des millénaires de connaissances humaines sur le sujet.
Avec tant de papyrus médicaux, la médecine égyptienne devrait être bien connue. Toutefois, ces textes sont essentiellement des manuels pratiques: ils ont été rédigés pour permettre à un médecin de diagnostiquer les pathologies dans son exercice quotidien et de proposer un traitement adapté. Ce ne sont pas des traités théoriques au sens moderne du terme (qui expliquent les maladies) et, pour cette raison, leur abord par un médecin du XXème siècle est difficile. Leurs premiers éditeurs se sont tout d'abord souciés d'en faire une édition pratique et scientifiquement irréprochable. Ces manuscrits sont écrits en hiératique, une écriture cursive, dérivée des hiéroglyphes, difficile à lire directement. Aussi les textes ont été tout d'abord transcrits en hiéroglyphes, puis les passages similaires entre les différents papyrus ont été regroupés, et le corpus ainsi établi a été muni d'un indispensable index.
C'est en Allemagne que fut entrepris ce travail entre 1954 et 1963, bien longtemps après la découverte des sources elles-mêmes. La grande publication qui s'ensuivit (Grundriss des Medizinder Alten Agypter), soit «Manuel de médecine de l'ancienne Égypte» restera longtemps encore l'instrument de travail indispensable à toute étude sur la médecine et les textes médicaux égyptiens. Cependant, ce travail est essentiellement une étude critique des textes par comparaison systématique des manuscrits.
La présentation des textes médicaux n'est généralement pas faite, papyrus par papyrus, mais regroupe les remèdes selon un ordre particulier, en fonction des différentes parties du corps et par référence à des listes anatomiques que l'on trouve dans les textes religieux égyptiens. Cette approche surtout philologique, tout en étant nécessaire, ne répond pas toujours aux questions que se pose l'historien de la médecine sur les conceptions médicales elles-mêmes.
L'apparente modernité de la médecine égyptienne
Quelques spécialistes ont aussi essayé d'identifier les pathologies décrites dans les papyrus. Ces essais d'identification terme à terme avec la nomenclature moderne sont fondés sur des traductions équivoques et on doit y renoncer. Par exemple, plusieurs auteurs ont traduit setet par «rhumatismes», alors qu'il s'agit d'éléments pathogènes vivants qui créent des douleurs par leur passage dans les conduits corporels. Certes, il existe un réel pathologique (le nôtre !) et le médecin égyptien avait bien en face de lui des maladies réelles.
On peut dans certains cas, lorsque la maladie a une manifestation externe évidente et que cette dernière est bien décrite dans le texte médical (le meilleur exemple étant celui des maladies de la peau), proposer une identification probable avec le terme antique. Encore faut-il comprendre que l'on identifie ainsi la maladie réelle dont souffrait le malade examiné, et non l'idée que les médecins égyptiens s'en faisaient. Le danger constant est d'attribuer au médecin antique certaines connaissances que nous possédons aujourd'hui.
En 1930, la publication du papyrus Smith eut un grand retentissement sur l'appréciation que l'on portait sur les connaissances médicales des Égyptiens. S'opposant à première vue au reste de la littérature médicale, le papyrus Smith semblait quasi scientifique: il décrit successivement les blessures du corps en suivant un ordre logique et ne fait presque pas appel aux causes occultes. Cette originalité apparente ne repose que sur une erreur d'appréciation.
Les signes objectifs des atteintes décrites sont si scrupuleusement notés dans ce papyrus que l'on a parfois considéré que le rédacteur ancien percevait le lien de causalité qui, pour nous, relie les observations rassemblées. Il n'en est rien: le papyrus Smith, en collectant soigneusement les observations médicales de différentes blessures, veut permettre au médecin de faire correspondre le cas particulier du blessé qu'il examine avec une description type qui met en relation la blessure, sa gravité, et les signes cliniques rencontrés habituellement.
En outre, les théories médicales décrites ne s'éloignent pas des théories en faveur à l'époque. Certains passages du papyrus Smith renvoient ainsi à ces théories selon lesquelles tout désordre entraîné par une lésion s'explique par la perturbation des souffles de vie parcourant l'intérieur du corps et par l'action d'éléments dangereux qui profitent de l'état du blessé pour l'envahir.
En 1995, j'ai donné une nouvelle traduction de la totalité des textes médicaux égyptiens édités. Les interprétations qui s'ensuivirent s'inscrivent dans le souci actuel des chercheurs en histoire des sciences, qui, plutôt que juger, tâchent de comprendre «de l'intérieur» la pensée des Anciens pour en retrouver la logique interne.
4. DU TEMPLE FUNÉRAIRE de Ramsès II (Ramesséum, XIXè dynastie, 1200 ans avant notre ère) , à Thèbes, proviendraient les papyrus médicaux les plus importants: le papyrus Ebers et le papyrus Smith. Les magasins de ce temple recouvraient en outre un ancien cimetière de la XIIè dynastie (2000 ans avant notre ère), ou furent retrouvés les plus anciens papyrus médicaux connus à ce Jour (papyrus du Ramesseum).
5. LES LIEUX DE DÉCOUVERTE des plus importants papyrus médicaux sont Thèbes (papyrus Ebers et Smith), Memphis (papyrus de Berlin), Deir el-Ballas (papyrus Hearst). On ignore le plus souvent la provenance des autres papyrus médicaux, qui sont issus de fouilles clandestines.
Les souffles, cause de maladie
Dans ces textes, on ne trouve pas de noms de maladies au sens moderne du terme, c'est-à-dire des mots ou des expressions dénommant un état pathologique particulier, caractérisé par un ensemble de symptômes. De nombreux passages indiquent des listes de symptômes qui étaient associés chez les personnes souffrant de certaines maladies, mais nous l'avons dit, les maladies elles-mêmes n'étaient pas nommées. Les Égyptiens n'identifiaient pas les maladies; ils cherchaient les causes des symptômes individuels.
On pensait que les troubles résultaient le plus souvent de l'action d'agents extérieurs (substances animées par un souffle pathogène) contre lesquels étaient alors prescrites des médications destinées à les détruire ou à les chasser. Le corps n'était pas malade en lui-même, il était agressé. La médecine égyptienne cherchait les causes pathogènes reconnues.
Cette recherche étiologique (la recherche des causes) résulte des conceptions égyptiennes sur l'origine du monde organisé. Pour les Égyptiens, le monde avant son organisation par les dieux se résumait à un univers liquide, le Noun, où se trouvaient en solution tous les éléments constitutifs du monde à venir. Les éléments qui constituaient le monde organisé et hiérarchisé qu'ils avaient sous les yeux, se trouvaient à l'origine dispersés dans une sorte de boue liquide où le corps même du dieu créateur était dissous. L'émergence de ce dieu créateur par une sorte de sédimentation naturelle expliquait l'organisation des éléments dispersés. Dès lors, l'intervention directe du dieu dans l'équilibre du monde ne cessait jamais. Le Noun, réservoir de germes de vie, persistait à la périphérie du monde déjà bâti.
A chaque crue, le Nil, dont la source était cet inépuisable réservoir, apportait de quoi créer de nouveaux organismes. Selon cette conception, le développement d'un simple épi de blé ne se réduisait pas à la croissance d'un grain placé dans le limon fertile. La crue apportait en solution dans son flot les éléments constitutifs de cet épi, et le grain que jetait le paysan ne jouait que le rôle d'une matrice où ces éléments constitutifs se liaient par un processus divin. L'intervention des dieux était constante autour de l'homme et dans l'homme. Toute recherche des causalités s'y ramenait, et toute spéculation médicale se déroulait dans le cadre étroit des causalités divines.
Cette vision du monde ne s'opposait pas à une véritable réflexion médicale. Au contraire, dans un monde où les dieux agissaient de toutes parts, on devait observer scrupuleusement les phénomènes pour comprendre les agissements divins. Cette observation permettait aux Égyptiens de concevoir comment s'exprimaient les modalités de la vie à l'intérieur d'un corps humain, c'est-à-dire, en termes modernes, comment le corps «fonctionnait».
L'analyse des textes montre comment la question de l'origine des maladies est tributaire de cette conception générale sur l'origine des choses: l'idée première étant toujours celle de l'intervention divine, les éléments constitutifs du corps humain n'ont pas de propriétés fixées; ils sont le jouet de forces supérieures normalement bénéfiques (observation de l'état de santé), mais parfois néfastes (observation des signes de la maladie). Pour les Égyptiens, ces forces ont une réalité matérielle: ce sont des souffles actifs ou des substances pathogènes, animées par ces souffles, qui circulent dans les conduits du corps et qui perturbent sa bonne organisation. Lorsque ces souffles s'introduisent dans le corps, certains constituants normaux du corps ont un rôle néfaste à cause du souffle pathogène qui les anime. Ces souffles peuvent encore entraîner des fausses routes pour les sécrétions corporelles naturelles, qui envahissent alors le corps.
De nombreuses substances pathogènes sont animées par un souffle morbide qui dicte leur action et leur permet de s'insinuer dans le corps, de s'y déplacer, de le ronger et de le perturber. Trois d'entre elles, le sang, le âaâ et les oukhedou, très souvent citées dans les textes, illustrent la démarche intellectuelle propre aux praticiens de l'Égypte ancienne.
Le sang, bénéfique et dangereux
«Le dieu Khnoum est le maître du souffle; la vie et la mort obéissent à ses décisions. Celui qui est vide de lui [du dieu, donc du souffle], le sang manque en lui». Ce texte tiré des hymnes au dieu Khnoum du temple d'Esna (en Haute-Égypte) correspond à l'idée égyptienne constamment affirmée sur le sang: un liquide bénéfique animé par le souffle de vie, support même de la vie.
D'autres textes exposant des théories égyptiennes sur la création des formes de vie indiquent que le rôle habituellement dévolu au sang est celui de «lier», rôle bâtisseur qui explique la formation et le développement de l'embryon, puis la croissance de l'être humain (le sang «lie» alors l'alimentation en chairs).
Toutefois, certains passages des textes médicaux consacrés aux «substances qui rongent» attestent que le sang peut avoir un rôle pathogène. Le sang, animé alors par un souffle pathogène, se met à «manger», lit-on dans les textes. Il y aurait alors inversion pathologique du rôle du sang, ce qui en ferait un facteur particulièrement dangereux du fait de sa présence dans tout le corps. D'autres textes indiquent que, lorsque le sang ne lie pas les éléments composant le corps ou les aliments qui y pénètrent, il bloque le passage des souffles de vie. L'interprétation égyptienne des processus morbides tient compte des conceptions physiologiques de l'époque.
6. DES FACTEURS PATHOGENES CIRCULANTS semblaient être la cause de nombreux processus morbides. Le âaâ, émanation corporelle d'essence dlvine, pouvait se transformer en vermine intestinale. Il se transformait aussi en oul-hedou dont l'action décomposante provoquait les inflammations et la putréfaction des chairs.
Le âaâ, source de vie et source de troubles
Le âaâ est une autre substance qui joue parfois un rôle pathogène. Un passage du traité de physiologie du papyrus Ebers indique qu'il provient du corps: «Quatre conduits se divisent au niveau de la tête et se déversent dans la nuque, puis ensuite, forment un réservoir. Une source/puits de âaâ, c'est ce qu'ils forment extérieurement à la tête.» Il existe toute une famille de mots appartenant à la même racine linguistique âaâ et trouvés dans des contextes variés. Il y a tout d'abord un rapport avec l'eau fertilisante, celle du Nil, nommée parfois âaâ. Dans les substantifs de la famille âaâ, on retrouve constamment l'idée de «semence», émanation corporelle divine. Si le âaâ n'est pas uniquement le sperme, il garde toujours, dans les textes médicaux et non médicaux, le sens vague de fertilisant d'origine corporelle.
On retiendra le sens de «sécrétion corporelle», de fluide parfois émis par les corps des dieux et des démons, de liquides capables de se transformer dans l'organisme en éléments parasites variés.
En raison de ses transformations, ce âaâ était tenu pour particulièrement dangereux. Les Égyptiens le croyaient notamment à l'origine de la vermine intestinale. Dans le passage du papyrus Ebers cité précédemment, le âaâ est le sébum (une sécrétion grasse produite par des glandes sur la peau et sur le cuir chevelu), considéré comme une véritable semence. On peut supposer qu'il existait une théorie faisant jouer à ce âaâ-sébum un rôle essentiel dans la multiplication de la vermine qui infeste le corps des hommes (les poux notamment). L'une des principales actions nocives du âaâ est, nous allons le voir, d'être à l'origine de facteurs pathogènes très importants, les oukhedou.
Les oukhedou, éléments rongeants maléfiques
Nous avons vu comment le sang (sauf quand il devenait pathogène) était considéré comme le principal facteur vital du corps, celui qui «lie» les chairs et bâtit le corps. Les textes médicaux font jouer aux oukhedou et au sang des rôles opposés. Les oukhedou sont liés aux matières en décomposition. Le sang agit dans un milieu vivant, alors que la présence oukhedou est synonyme de vieillesse et de mort.
Selon les informations que l'on peut tirer des textes, les oukhedou seraient des substances animées par un souffle pathogène qu'on incorporait sans cesse en s'alimentant. Leur présence semblait expliquer la dissolution, sinon la putréfaction, de la nourriture dans le ventre de l'homme. Ils jouaient un rôle nocif en délitant la substance corporelle, ils s'opposaient aux processus de cicatrisation (formation de pus par dissolution des chairs, action opposée à l'action liante du sang)
Les oukhedou provoquent la douleur par leur action rongeante. Cette idée est exprimée directement par le texte d'un paragraphe du papyrus Ebers: «Si tu procèdes à l'examen d'un homme qui est atteint de cela épisodiquement, cela étant comparable à la morsure des oukhedou». Les Égyptiens considéraient que la douleur résultait d'un grignotage des chairs.
Certains textes indiquent que le âaâ peut engendrer les oukhedou, mais la nature de ces derniers est différente: l'action pathogène des oukhedou ronge le corps lui-même, tandis que le liquide fertilisant âaâ est pathogène par les substances qu'il engendre.
Ces constructions théoriques, retrouvées par l'analyse des textes médicaux égyptiens, montrent que l'Égypte ancienne utilise une pensée. médicale élaborée.
L'art médical égyptien reposait sur des traditions et des façons de faire millénaires, certainement en partie antérieures à la période historique. Au cours des siècles, une science des signes pathologiques, fondement de toute activité médicale, s'élabora afin de déceler l'état de maladie et de reconnaître les agents pathogènes nombreux, animés par des souffles nocifs. Ainsi la médecine égyptienne était remarquable à aux moins deux titres: le choix des médications qui, en dehors d'un simple usage traditionnel pouvant remonter à la préhistoire, obéissait parfois à des critères complexes; le savoir théorique et les connaissances pratiques qui étaient demandés au médecin de l'époque.
Les médecins, techniciens de la maladie
Le nombre de papyrus égyptiens est suffisant pour nous renseigner sur les pratiques médicales de cette époque, mais qui sont leurs rédacteurs? Quelle était la place des médecins dans la société égyptienne ?
Ce qui frappe dans toute la littérature médicale égyptienne, c'est l'absence d'auteurs. Aucun traité médical de l'Égypte ancienne ne peut être attribué à un auteur particulier. On a recensé beaucoup de noms de médecins égyptiens, mais la documentation est essentiellement extra-médicale: inscriptions dans des tombes, sur des stèles, documentation administrative Nulle part il n'est affirmé qu'une doctrine ou un remède ont été élaborés par un médecin particulier.
Cette absence d'auteurs reconnus s'explique par l'importance toute particulière de la médecine du palais royal. Auprès du roi d'Égypte était rassemblé un cortège de grands médecins dont le rôle était de répandre à travers le pays les bienfaits attendus de l'art médical. Ils agissaient au nom du roi, délégué des dieux sur terre et seul garant, selon le dogme, de la santé de ses sujets. Une telle conception ne permettait à aucun praticien de la cour de se présenter comme un véritable auteur. Toutefois, autour du personnage du roi, se trouvait un médecin qui portait le titre de «Grand des médecins du palais» et qui était le médecin personnel du roi et le chef de tous les autres médecins d'Égypte.
Le plus ancien de ces «Grand des médecins» qui nous soit connu, Hésy-Rê, portait le titre de «Grand des dentistes et des médecins». Il est probable qu'à la longue, de tels titres n'étaient qu'un indice de rang hiérarchique pour la corporation des médecins du palais.
UN DES PANNEAUX DE BOIS trouvé dans la tombe de Hésy-Rê représente ce «Grand des médecins» de la IIIè dynastie (-2700).
L'activité principale de tous les praticiens de la cour était la rédaction de manuels médicaux, destinés au praticien de base, simple exécutant. Ils enferment ainsi l'activité quotidienne de ce dernier dans un cadre étroit: le médecin de tous les jours ne doit pas s'écarter des préceptes édictés par ses supérieurs hiérarchiques, sous peine de sanctions.
Pour comprendre cette organisation de la médecine du palais, on se fonde sur les mythes égyptiens, telle l'histoire de la querelle entre le dieu Horus, héritier présomptif du trône d'Égypte, et le dieu Seth, qui convoite cet héritage: Seth essaye d'abuser du jeune Horus qui, en se protégeant comme il peut, a les mains souillées par la semence de son rival. Isis coupe les mains de son fils, lui en fabrique de nouvelles, puis parvient à contaminer à son tour Seth en lui faisant ingurgiter la semence de son fils répandue sur des laitues dont il était friand. Alors, dit le mythe, du front de Seth sortit un disque d'or que le dieu Thot mit sur son front. La signification du mythe paraît être la suivante: la ruse (les pouvoirs magiques d'Isis) permet au monde civilisé et raisonnable (symbolisé par Horus) de faire un enfant au désordre (le monde désordonné de Seth) et d'engendrer un dieu (Thot) qui représente au mieux ce que sont, pour les Égyptiens, nos sciences appliquées (écriture, magie, médecine).
On a retrouvé dernièrement, dans un papyrus, une liste de titres de dignitaires de l'ancienne Égypte, liste qui place en face de chaque titre un nom de divinité qui symbolise la fonction qu'il incarne. Le «Chef des médecins et des dentistes, dont le rôle devait être analogue à celui de Hésy-Rê, est assimilé à «Thot né aux deux seigneurs», c'est-à-dire d'Horus et de Seth. Le recours au mythe peut expliquer ainsi l'organisation de la médecine égyptienne: sous la direction d'Horus-pharaon (celui qui doit rétablir l'ordre toujours en sursis), Thot-Grand-des-médecins (le technicien) est chargé de définir les moyens pratiques de la lutte contre Seth (représentant le désordre, la force destructrice, la maladie) et de les faire connaître dans tout le pays.
Références :
(1) Article paru dans « Pour La Science » N° 226 août 1996
T. BARDINET, Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique, Eayard, 1995.
P. GHALIOUNGUI, La médecine des pharaons, Robert Laffont, 1983.
M. D. GRMEK, Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale, Payot, 1983.
G. LEFEBVRE, Essai sur la médecine égyptienne de l'époque pharaonique, PUF, 1956. H. GRAPOW, W. WESTENDORF, H. VON DEINES, Grundriss des Medicin
